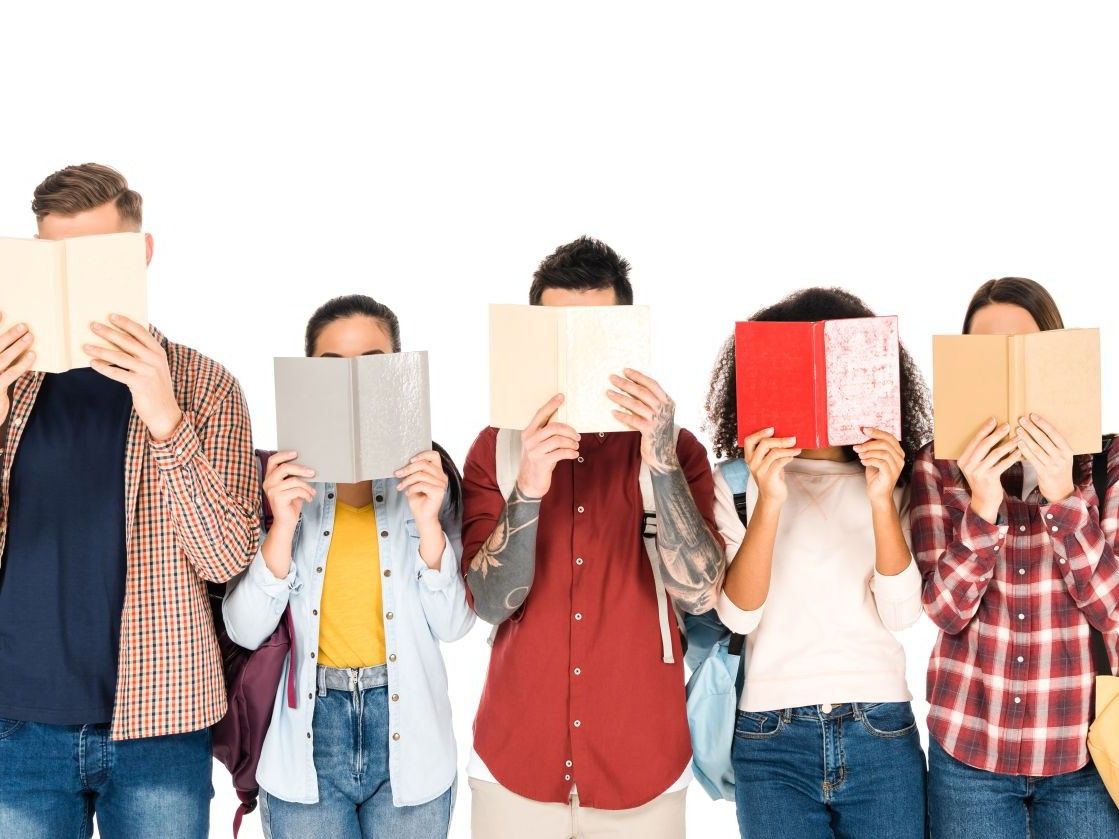La nouvelle stratégie nationale pour l'éducation à la citoyenneté(ENEC) a été rendue publique et vise à remplacer la précédente, datant de 2017, ainsi qu'une feuille de route, qui n'existait pas dans la version précédente, des apprentissages essentiels pour la discipline.
Cette mesure répond à une promesse électorale du gouvernement et aux critiques des secteurs les plus conservateurs selon lesquelles la discipline Citoyenneté et développement était trop axée sur des sujets qu'ils classent dans l'idéologie du genre.
"En tant qu'espace de développement individuel et collectif, l'école s'assume comme un lieu privilégié pour construire une culture de citoyenneté active, démocratique et responsable, partagée par tous, promouvant la cohésion sociale", lit-on dans le texte de l'ENEC, qui est ouvert à la consultation publique jusqu'au 1er août. "La société portugaise, dans son contexte national, européen et mondial, est confrontée à d'innombrables défis qui exigent des réponses fondées sur des valeurs éthiques, la connaissance des règles civiques et des institutions démocratiques, l'empathie et la solidarité sociale", indique le document, qui souligne que "l'éducation à la citoyenneté permet aux jeunes de développer des compétences de dialogue, une pensée critique et la conscience de leur rôle".
Dans les thèmes obligatoires et transversaux, la proposition du gouvernement met l'accent sur les droits de l'homme, la démocratie et les institutions politiques, le développement durable, la culture financière et l'esprit d'entreprise.
Un deuxième niveau d'importance est accordé à la santé, aux risques et à la sécurité routière, au pluralisme et à la diversité culturelle, ainsi qu'aux médias.
"Dans un contexte mondial où nous assistons à des risques croissants de fragmentation sociale, de désinformation et de polarisation, l'éducation à la citoyenneté correspond à un investissement dans la cohésion sociale autour des valeurs partagées des droits de l'homme, de l'égalité et de la non-discrimination, qui sont le fondement de l'État de droit démocratique portugais et des sociétés libres", peut-on lire dans le document. Une analyse de la proposition du gouvernement et de la stratégie actuelle conclut que l'attention portée à la sexualité ou à l'orientation sexuelle cesse d'exister et n'est abordée que dans le contexte des violations des droits de l'homme.
Ce n'est que dans le parcours d'apprentissage essentiel du troisième cycle et dans le chapitre sur les droits de l'homme que les élèves doivent "analyser des cas historiques et actuels de violations des droits de l'homme (y compris, entre autres, la traite des êtres humains, les abus sexuels, la violence fondée sur le genre, ainsi que la violence à l'encontre des personnes dont l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre ne sont pas normatives)".
En outre, ce n'est que dans cette phase, entre la 7e et la 9e année, que le programme prévoit de "discuter de l'(in)égalité des sexes dans des contextes tels que l'éducation, le travail et les fonctions politiques".
Quant à la maltraitance des animaux, mise en avant dans le programme actuel, la proposition du gouvernement prévoit qu'elle soit l'un des thèmes abordés dans le chapitre sur le développement durable pour les élèves du second cycle, les amenant à "réfléchir aux situations dans lesquelles l'action de l'homme peut compromettre le bien-être de l'animal". L'interaction avec d'autres cultures reste un point pertinent, la proposition actuelle incluant le terme "diversité culturelle" au lieu de "interculturalité", qui figure dans le programme actuel.
Dans la proposition, le gouvernement préconise que les élèves de l'école primaire apprennent à "faire preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité en apprenant à connaître les autres" et à "participer à des initiatives qui célèbrent et valorisent leur propre culture, ainsi que d'autres cultures, dans le cadre des valeurs constitutionnelles de la société portugaise", parmi d'autres sujets.
Les élèves de deuxième et troisième année sont invités à valoriser "la diversité culturelle dans le contexte scolaire", à discuter de "la pertinence de la protection des droits des minorités et de leurs cultures" et à reconnaître les "défis auxquels les migrants sont confrontés dans la société d'accueil". Ce n'est qu'au lycée que les élèves seront invités à "réfléchir de manière critique aux conséquences culturelles des processus actuels de mondialisation (homogénéisation contre différenciation et fragmentation)", à "analyser les différentes formes de discrimination, telles que le racisme, la xénophobie, l'antitsiganisme, l'islamophobie, l'antisémitisme et la misogynie" et à "débattre du rôle du dialogue interculturel et du pluralisme dans la cohésion de sociétés culturellement diversifiées".
L'une des nouveautés du programme est l'éducation financière et le thème de l'esprit d'entreprise. Les élèves les plus jeunes sont invités à "comprendre l'importance de l'épargne et ses objectifs" et à "faire la différence entre contracter des prêts (auprès de la famille, d'amis ou de banques) et accorder des prêts".
Les élèves plus âgés prépareront des budgets personnels et familiaux, ainsi que des budgets pour "un projet entrepreneurial, en tenant compte des partenariats stratégiques et des ressources nécessaires", en plus de "valider des idées innovantes qui peuvent générer de la valeur".
Le thème des "médias" figure également en bonne place dans la proposition soumise au débat public, qui vise à "encourager les enfants et les jeunes à interpréter l'information et à utiliser les médias sociaux, en particulier pour accéder aux technologies de l'information et de la communication et les utiliser, dans le but d'adopter des attitudes et des comportements appropriés pour une utilisation critique et sûre des technologies numériques, de l'information et des contenus générés par l'intelligence artificielle".
Les adultes plus âgés sont invités à soumettre des propositions visant à "transformer et améliorer l'environnement en ligne et le bien-être dans leur relation avec les médias numériques, afin de prévenir les risques en ligne (dépendance, cyberintimidation, discours haineux, polarisation, trolling, sexting, sextorsion, etc.)